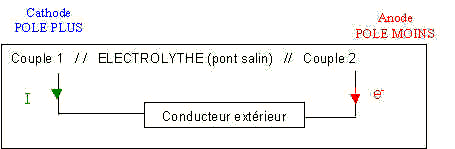
Classification électrochimique des métaux
Produits et Matériel :
Solutions 0,1 M de Zn2+ ; Cu2+ ; Fe2+ ; Ag+ - Solution 1M de CuSO4 -
Lames de : Zinc ; Fer ; Cuivre et Argent (2 de chaque) - Electrodes de Graphite (2) - Fil de Platine ou Electrode de Platine - Zinc en Grenaille - Zinc en poudre - Fer en poudre - Cuivre en tournure - Cuivre en Poudre - Solution de Soude 2 M - Solution d'Acide Chlorhydrique 1 M - Acide Chlorhydrique Concentré - Acide Sulfurique Commercial - Dichromate de Potassium Solide - Ponts Salins (6) (à défaut papier filtres imbibés de KNO3) - Multimètres Numériques (3) - Tubes à Essais (12) - Portoirs (2) - Pipettes Compte-gouttes (4) - Bechers 100 ml (10) - Bechers 500 ml (2) - Bechers 250 ml (6) - Cristallisoir - Entonnoirs (2) -
Introduction :
Nous allons montrer que les métaux et leur cations forment des couples oxydo-réducteurs susceptibles de donner des réactions chimiques par échange d'électrons entre les différentes formes oxydantes et réductrices de deux couples différents. Ces réactions peuvent se faire directement par action d'un métal sur un ion métallique appartenant à un autre couple ou par l'intermédiaire d'un conducteur extérieur dans une pile. L'étude de ces diverses réactions nous conduirons à un classement des divers ions métalliques selon leur pouvoir oxydant. Ce classement qualitatif sera complété ensuite par un classement quantitatif grâce à l'étude des piles. Nous définirons ensuite la notion de potentiel de référence d'oxydo-réduction et la situation particulière du couple H+ / H2. Enfin, nous réaliserons une pile capable de débiter un courant important et utilisant le couple Zn2+ / Zn : la pile de Bunsen.
Données Thermodynamiques :
H3O+/H2 E0 = 0 v Zn2+ / Zn E0 = - 0,76 V
Cu2+ / Cu E0 = 0,34 V Pb2+ / Pb E0 = - 0,13 V
Ag+ / Ag E0 = 0,80 V Fe2+ / Fe E0 = - 0,44 V
I) Réactions entre un métal et le cation d'un autre métal :
1) Réaction entre le métal zinc et l'ion cuivre (II) :
a) Réaction :
Dans un tube à essais, verser 5 ml d'une solution de sulfate de cuivre 1 M, puis ajouter 1 bonne spatulée de zinc en poudre. Le zinc se recouvre d'un dépôt rougeâtre, et la température augmente sensiblement. Le montrer au toucher ou a l'aide d'un thermomètre. Il se produit une réaction chimique exothermique. Boucher le tube et agiter énergiquement, la solution bleue se décolore petit à petit. Laisser reposer pour que la poudre de zinc se décante. (Eventuellement filtrer sur entonnoir + Coton).
b) Caractérisation des réactif et des produits :
Montrer l'action de la soude sur une solution de sulfate de cuivre. Dans un tube à essais introduire un peu de solution puis ajouter goutte à goutte un solution de soude 1M. Il se forme un précipité bleu gélatineux d'hydroxyde de cuivre (II) Cu(OH)2 insoluble dans un excès de soude. Procéder de la même manière avec une solution de sulfate de zinc. Il se forme un précipité blanc gélatineux d'hydroxyde de zinc (II) Zn(OH)2 qui lui, est soluble dans un excès de soude par formation du complexe Zn(OH)42-. Prélever un peu de la solution décolorée du a) et faire le test à la soude, la formation d'un précipité blanc soluble en excès montre la formation de Zn2+. La décoloration de la solution montre la disparition de l'ion Cu2+. Le dépôt rougeâtre ne peut être que du cuivre métallique.
c) Conclusion :
La réaction est : Cu2+ + Zn ---> Cu + Zn2+
Il y a eu échange d'électrons entre les deux réactif de départ il s'agit d'une réaction d'oxydo-réduction. L'ion Cu2+ est l'oxydant, le métal zinc est le réducteur.
2) Réaction entre le métal fer et l'ion cuivre (II) :
Procéder exactement de la même manière. L'ion Fe2+ est caractérisé par la formation de Fe(OH)2 de couleur verte.
3) Généralisation à d'autres métaux :
Dans un becher de 100 ml introduire un peu de la solution d'un ion métallique, puis y plonger une lame d'un autre métal.
Réaliser ainsi : (Cu2+ ; Fe) ; (Cu2+ ; Zn) ; (Fe2+ ; Zn) ; (Ag+; Cu) ; (Ag+ ; Fe) ;
(Ag+ ; Zn) ; (Fe2+; Cu) ; (Zn2+ ; Cu) ; (Zn2+ ; Fe) ; (Cu2+ ; Ag)
Laisser les réactions se faire et montrer le résultat.
L'argent se dépose sur tous les autres métaux.
Le cuivre se dépose sur le zinc et le fer, mais ne se dépose pas sur l'argent.
Le fer se dépose sur le zinc mais pas sur le cuivre et l'argent.
Le zinc ne se dépose sur aucun des autres métaux.
2) Classement qualitatif des ions métalliques selon leur pouvoir oxydant (ou des métaux selon leur pouvoir réducteur)
Les expériences précédantes permettent de classer les ions métalliques selon leur pouvoir oxydant. L'ion Ag+ est capable d'oxyder tous les métaux étudiés. L'ion Ag+ est donc le meilleur oxydant parmi les ions étudiés. Inversement le métal zinc est capable de réduire tous les cations métalliques étudiés. Le métal zinc est donc le meilleur réducteur parmi les métaux étudié.
On obtient le classement qualitatif suivant :
a) Selon le pouvoir oxydant de l'ion métallique :
Zn2+ < Fe2+ < Cu2+ < Ag+
b) Selon le pouvoir réducteur du métal :
Ag < Cu < Fe < Zn
c) Notion de Couple Oxydo-réducteur :
Les deux tableaux précédant peuvent être résumé en un seul qui va classer les couples ion métallique/métal. On place les couples sur un axe horizontal, l'ion métallique (oxydant) en haut, le métal (réducteur) en bas. Le pouvoir oxydant augmente vers la droite, le pouvoir réducteur vers la gauche.
Zn2+ Fe2+ Cu2+ Ag+
-I----------I----------I----------I--------> Pouvoir Oxydant
Zn Fe Cu Ag
III) Place du Couple H+ / H2 :
Le couple H+ / H2, est un couple oxydo-réducteur particulièrement important, bien que non métallique, nous allons le situer dans le tableau précédant.
1) H+ est capable d'oxyder le fer :
Pour le montrer introduire un peu de fer en poudre dans un tube à essai puis verser 1 ou 2 ml d'une solution d'acide chlorhydrique 1 M. On observe un dégagement de dihydrogène que l'on caractérisera en le faisant aboyer à la flamme. Caractériser ensuite les ions Fe2+ formés par la soude. (Si l’attaque ne se produit pas ajouter une goutte d’acide concentré pour la faire démarrer).
2) H+ n'est pas capable d'oxyder le cuivre :
Procéder de la même manière avec du cuivre en tournures, aucune réaction ne se produit.
3) Place du couple H+/ H2 :
Le Couple H+/H2 est donc situé entre les couples (Fe2+ / Fe) et (Cu2+ / Cu). Le rajouter au tableau précédant.
IV) Classement quantitatif des couples :
1) Pile Zinc-Cuivre :
a) Réalisation d'une Pile :
Réaliser une pile : Cu / Cu2+ / Pont Salin / Zn2+ / Zn.
Mesurer sa f.e.m à l'aide d'un multimètre numérique, on trouve 1,1 V.
Montrer que le pôle + est sur le cuivre et le pôle - sur le zinc.
b) Interprétation :
La mesure de la f.e.m permet de déduire la circulation d'un courant électrique. L'identification des pôles de la pile permet de déduire le sens de circulation des électrons dans le conducteur extérieur. Les électrons sont produits à l'électrode de zinc et consommés à l'électrode de cuivre. Le zinc est donc oxydé en Zn2+ fournissant au circuit extérieur deux électrons qui vont aller à l'électrode de cuivre. A l'électrode de cuivre les ions Cu2+ captent les électrons fournis par le conducteur extérieur et donnent du cuivre métallique.
Schématisation de la Pile :
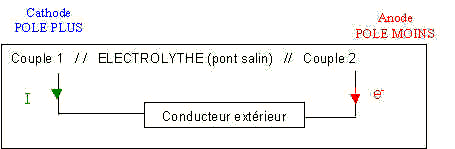
Pôle MOINS : Zn ---> Zn2+ + 2 e-
Pôle PLUS : Cu2+ + 2 e- ---> Cu
Bilan : Zn + Cu2+ ---> Zn2+ + Cu
On retrouve l'équation bilan de la première réaction étudiée.
Ici l'échange électronique se fait par l'intermédiaire du conducteur extérieur.
Remarque : Par définition, l'anode est l'électrode où se produit la réaction d'oxydation et la cathode est l'électrode où se produit la réaction de réduction. Le pôle moins de la pile est donc l'anode et le pôle plus la cathode. C'est l'inverse pour une cellule d'électrolyse.
2) Généralisation :
Réaliser les piles suivantes (par exemple) et mesurer leur f.e.m :
(Ag / Cu) ; (Fe / Cu) ; (Fe / Zn). Montrer que leur pôle + est respectivement sur Ag, Cu et Fe. Interpréter les réactions qui se produisent aux électrodes et montrer qu'on retrouve le classement qualitatif précédant.
3) Classement quantitatif des couples :
Utiliser les valeurs des f.e.m trouvées pour classer quantitativement les couples. Sur un axe on placera les divers couples en les écartant d'une distance proportionnelle à la f.e.m de la pile les mettant en jeu.
4) Prévision de la f.e.m d'une pile :
Utiliser le tableau pour prévoir la f.e.m de la pile (Ag / Zn) et vérifier expérimentalement le résultat obtenu.
V) Notion de potentiel de référence d'oxydo-réduction :
On a pu classer quantitativement les couples par mesure de différences de potentiel. Il est tentant d'attribuer une valeur définie pour le potentiel de chaque couple. Pour cela on doit choisir arbitrairement un couple de référence à qui on attribuera un potentiel nul. Le couple choisi comme référence de potentiel est le couple H+/H2.
1) Réalisation d'une Electrode de Référence à Hydrogène simplifiée
Dans un cristallisoir ou un gros becher, introduire une solution 1 M d'acide chlorhydrique. Rajouter du zinc en grenaille. Introduire un fil de platine (ou mieux une électrode de platine) et le mettre en contact avec la solution. Le zinc est attaqué et du dihydrogène se dégage. On à réalisé une 1/2 pile mettant en jeu le couple H+ / H2 ; par convention on pose un potentiel nul pour cette demi-pile. (Laisser la réaction se faire 5 à 10 minutes, si le dégagement de dihydrogène ne se produit pas on peu " tricher " un peu en décapant le zinc par HCl concentré avant de l'introduire dans le becher).
2) Réalisation de piles utilisant l'E.R.H :
En associant cette demi-pile à d'autres on réalisera des piles dont on pourra mesurer la f.e.m. (borne COM sur E.R.H et V/mA/Ohm sur l'autre demi-pile). Ne pas oublier le pont salin.
Réaliser les piles (Ag/E.R.H) ; (Cu;E.R.H) ;(Zn;E.R.H). Par définition la f.e.m de la pile est égal au potentiel normal du couple utilisé.
Comparer avec les valeurs de la littérature.
Réaliser le classement définitif des couples en portant les valeurs des E0 sur le tableau précédant.
Remarques :
* Cette électrode simplifiée n'est pas une véritable électrode de référence, elle donne néanmoins de bons résultats en général. Il faut veiller à mettre le fil de platine très près des grenailles de zinc mais sans toucher celles-ci si on veut avoir de bons résultats. (Si on touche le Zinc on obtient le potentiel de celui-ci)
** Le couple Fe2+/Fe pose un problème particulier. En effet l'ion Fe2+ forme des complexes stables avec la plupart des anions ce qui modifie sensiblement le potentiel de référence du couple.
*** Pour obtenir les vraies valeurs des potentiels de référence on devrait utiliser des solutions molaires des ions étudiés. L’utilisation de solution 0,1 M introduit une erreur quasiment négligeable de 0,06 V (loi de Nernst).
VI) Utilisation pratique : Pile de Bunsen :
La pile de Bunsen utilise le zinc comme réducteur et le dichromate de potassium comme oxydant. Dans un becher, introduire une solution de dichromate de potassium acidifiée par H2SO4. Cette solution peut être préparée par dissolution de 10 g de K2Cr2O7 dans un litre d'eau distillée puis ajout avec précautions de 35 ml d'acide sulfurique commercial (66°Baumé). Introduire une électrode de zinc et une électrode de graphite. La f.e.m de cette cellule est d'environ 2 V. Monter deux cellules en série pour disposer de 4 V. Relier la pile à une ampoule 3,5 V, celle-ci brillera plusieurs heures.